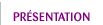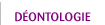L’Association des Fournisseurs d’Accès et de Services Internet (AFA) accueille avec satisfaction la proposition des organisations représentatives de la filière cinématographique concernant le développement d’une offre légale de films sous forme de vidéo à la demande (VOD). Cette proposition, dont les termes appellent des commentaires, arrive après une longue période au cours de laquelle l’AFA avait demandé instamment le développement de telles offres.
Non seulement avantageuse pour le spectateur qui bénéficiera à terme d’une offre riche, diverse et renouvelée, la vidéo à la demande est une formidable opportunité pour le cinéma de bénéficier d’une nouvelle fenêtre d’exposition.
Les discussions engagées à l’initiative des pouvoirs publics devraient se poursuivre en concertation avec ces mêmes pouvoirs publics : Ministère de la Culture, Ministère de l’industrie, Centre National de la Cinématographie.
En l’état, si une charte venait à être conclue entre fournisseurs d’accès Internet fixe et filière cinématographique, elle devrait, comme la charte sur la musique en ligne, reposer sur trois piliers :
- communication et sensibilisation des internautes
- développement des offres légales
- prévention et répression
1. La communication et la sensibilisation des internautes
Des mesures de communication et de sensibilisation des internautes ont été prévues dans le cadre de la charte sur la musique en ligne signée le 28 juillet 2004. Ces mesures ont commencé à être mises en en ouvre par les fournisseurs d’accès et les entreprises du secteur de la musique.
Les mêmes mesures pourraient également être envisagées dans le cadre d’un accord avec la filière cinématographique et pourraient être déclinées comme exposé ci-dessous.
Les fournisseurs d’accès Internet engageraient une communication à l’égard de leurs abonnés sur l’illégalité et les dangers pour l’avenir de la création et la production cinématographiques française des échanges illicites sur les réseaux peer-to-peer et la mise en avant de services légaux de téléchargement de films.
Pour leur part, les entreprises du secteur cinématographique communiqueraient auprès du public sur la possibilité innovante de télécharger des films légalement.
Des actions communes pourraient être mises en ouvre, les fournisseurs d’accès utilisant la large audience de leurs portails pour relayer des messages à vocation pédagogiques. Il doit toutefois être gardé à l’esprit que si une coordination peut exister pour ce qui concerne les actions de communication, tant les fournisseurs d’accès Internet que les organisations du secteur cinématographique doivent rester libres des moyens mis en ouvre.
2. Les conditions du développement d’une offre légale
La VOD est de la vidéo
La démarche des fournisseurs d’accès membres de l’AFA est de s’inscrire dans le cadre général de fonctionnement de l’industrie cinématographique française. Il n’est pas dans l’intention d’acteurs responsables de remettre brutalement en cause les schémas existants au risque de perturber ce secteur. Dans le même temps, tout le monde s’accorde à dire que les modèles doivent évoluer pour suivre les changements tant d’ordre technologique que d’usage et de consommation ; il serait illusoire d’adopter un comportement attentiste en espérant préserver des situations acquises.
Il est essentiel de préciser tout d’abord que la vidéo à la demande est à la fois distincte d’un service de télévision et assimilable à la vidéo, tant d’un point de vue du mode de consommation et des usages que juridiquement et fiscalement.
La distinction entre un service de télévision et un service de communication au public en ligne est clairement inscrite au nouvel article 2 de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication puisqu’« Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Or la VOD se définit quant à elle par une offre permanente et illimitée, consommée en mode streaming ou via un téléchargement, avec une durée limitée et offrant au spectateur la possibilité d’avancer, de reculer, d’accéder à un chapitrage ou de mettre le programme en pause. En cela, la VOD est par nature totalement assimilable à la vidéo.
La VOD, comme la vidéo, reste un moyen d’accéder à un programme au moment où le spectateur souhaite le consulter. Il en va différemment de la télévision, même lorsqu’il s’agit d’un système de paiement à la séance (PPV) car, dans ce dernier cas, le service n’est accessible qu’à un moment donné pour l’ensemble des spectateurs.
Les services de VOD se posent donc clairement en substitution des services de vidéo, qu’ils soient à la vente ou à la location, et non en concurrents de chaînes de télévision à péage comme ces dernières semblent le craindre.
Cette assimilation a par ailleurs été consacrée juridiquement à de nombreuses reprises.
Ainsi, la loi n°96-299 du 11 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, précise que « Le délai à l’issue duquel les services [qui transmettent à la demande des ouvres cinématographiques ou audiovisuelles] peuvent diffuser une ouvre cinématographique de longue durée après sa première exploitation en salle est identique à celui applicable aux vidéocassettes ».
De même, dans son rapport du 2 juillet 1998 sur « Internet et les réseaux numériques », le Conseil d’Etat confirme une nouvelle fois cette assimilation puisque « par souci de neutralité, il importe de ne pas chercher à réglementer spécifiquement des services au motif qu'ils sont offerts selon de nouvelles modalités (et notamment via Internet), et de veiller au contraire à ce que les exigences imposées à des services soient comparables s'ils sont substituables. Ainsi, le respect de la " chronologie des médias " s'impose à la vente de vidéocassettes en magasins et devrait donc aussi s'appliquer aux services interactifs de vidéo à la demande qui sont en pratique substituables. ».
Enfin, fiscalement, la VOD est également assimilée à la vidéo puisque selon l’article 302bis KE du Code général des impôts « est assimilée à une activité de vente ou de location de vidéogrammes la mise à disposition du public d'un service offrant l'accès à titre onéreux à des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ».
Les règles découlant de ce principe
Du principe ci-dessus rappelé découlent certaines règles. Si l’on s’en tient dans un premier temps à celles proposées par la filière cinématographique, les points suivants peuvent être avancés.
La sécurisation des échanges
La sécurisation des fichiers est une nécessité, quelles que soient les modalités de transmission des fichiers. Aujourd’hui, deux usages sont en développement : le téléchargement de films depuis un ordinateur personnel et la consultation de contenus sur le téléviseur branché à un modem haut débit. L’utilisation de l’ordinateur personnel pour accéder à des contenus est déjà couramment employé par les plates-formes légales de musique en ligne. Ce mode de diffusion a été jugé suffisamment sûr par la filière musicale. Dans ces conditions, demander que la VOD ne puisse être diffusée que sur un téléviseur revient à éliminer sans raison un usage grandissant des consommateurs. Une telle demande est par ailleurs pratiquement impossible à mettre en ouvre dans la mesure où la définition même de téléviseur ne permet pas d’en écarter un ordinateur recevant des programmes de télévision, assimilable, au moins fiscalement, à un récepteur de télévision.
Les modalités de l’offre VOD
La proposition présentée à l’AFA précise que les offres à intervenir devront être à l’acte ce qui interdirait toute offre d’abonnement ou d’achats de jetons ou de crédits. Des services comprenant un abonnement permettant une consultation illimitée d’ouvres existant déjà dans le secteur de la vidéo, l’AFA souhaite que les offres de VOD puissent bénéficier des mêmes prérogatives que le secteur auquel il est assimilable par nature.. Par ailleurs, des services équivalents existent également s’agissant d’autres ouvres (cf. les offres d’écoute de musique sur abonnement).
Quant à une éventuelle similitude entre SVOD et télévision payante, elle ne saurait être considérée comme pertinente, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ayant même précisé récemment que VOD et SVOD étaient soumis au même régime de la communication publique en ligne.
La rémunération des ayants droit
Toute offre de VOD ne pourra être mise en ouvre que moyennant une rémunération juste des ayants droit. A ce titre, l’AFA souhaite préciser qu’elle est entièrement ouverte aux discussions sur ses modalités précises afin d’obtenir un accord juste et équitable. Il est néanmoins impératif de conserver à l’esprit que les offres devront à la fois être attractives pour le grand public et permettre à l’ensemble des acteurs de ce nouveau type de services, et notamment aux plates-formes de distribution de films, de conserver la rentabilité nécessaire pour développer une offre pérenne.
Communication et publicité
La proposition de plate-forme présentée par la filière cinématographique consiste à ne permettre aux distributeurs de services de VOD qu’une communication sur les ouvres disponibles qu’à compter du jour où elles le sont effectivement. Une telle mesure, si elle venait à être appliquée, interdirait aux distributeurs de promouvoir efficacement leurs produits. L’AFA propose que le régime de la vidéo soit naturellement appliqué à la VOD et que les distributeurs puissent promouvoir leurs services et les ouvres qu’ils diffusent avec un délai maximum de 45 jours avant que ces dernières soient disponibles en ligne.
Obligation d’investissements
Il est demandé aux futurs distributeurs d’ouvres en vidéo de supporter des obligations de préfinancement dès lors qu’un certain volume d’activité (chiffre d’affaires, nombre d’actes de consommation) aura été dépassé. L’AFA s’étonne qu’il soit demandé aux futurs distributeurs d’ouvres sous forme de vidéo à la demande des contraintes financières qui seraient différentes de celles applicables au secteur de la distribution vidéo traditionnelle. Elle préconise plutôt que les entreprises qui feront le choix de prendre des risques en investissant dans des plates-formes de vidéo à la demande puissent bénéficier du soutien du CNC.
Par ailleurs, les fournisseurs d’accès pourraient prendre des engagements (sous réserve de disponibilité de titres) de proposer un volume d’ouvres contenant un certain nombre de films d’expression originelle française et/ou européenne.
L’insertion dans la chronologie des médias
La filière cinématographique propose que la VOD soit insérée dans la chronologie des médias de la façon suivante :
- pour les films ayant fait moins d’un million d’entrées : accessibilité dans un délai de 9 mois après la délivrance du visa d’exploitation.
- pour les films ayant fait plus d’un million d’entrées : accessibilité dans un délai de 12 mois après la délivrance du visa d’exploitation.
La raison donnée au mécanisme ainsi mis en ouvre est la volonté de protéger les chaînes payantes qui financent la production cinématographique. Or l’offre de VOD est, tant par sa nature que du fait des usages du public, substituable à la vidéo et non à la télévision payante de type premium cinéma. Elle doit donc bénéficier des mêmes obligations mais aussi des mêmes droits que la vidéo.
Dès lors, fixer une fenêtre plus tardive pour la VOD que pour la vidéo reviendrait à pénaliser considérablement la VOD alors même qu’il s’agit d’un nouveau service qui doit encore faire ses preuves.
Pour cette raison, l’AFA propose que la VOD soit insérée dans la chronologie des médias au même niveau que la vidéo et que tout titre dont l’exploitation aurait fait l’objet d’une dérogation par le CNC pour une exploitation sur support vidéo puisse simultanément être accessible en VOD.
Enfin, l’AFA accueille avec satisfaction la proposition contenue dans la plate-forme que la fenêtre attribuée à la VOD qui, comme la vidéo actuellement, une fois ouverte, ne se referme pas.
L’ouverture des catalogues
Il est indispensable que les services de VOD soient exhaustifs. A cette fin, la participation des producteurs cinématographiques est cruciale pour que les fournisseurs de services de VOD aient les droits pour diffuser les ouvres attendues par le public.
La charte que l’AFA appelle de ses voux devra prévoir des engagements clairs, tant en termes de quantité qu’en termes de pertinence et de diversité des contenus.
3. Prévention et répression
Troisième pilier de l’action nécessaire pour pouvoir simultanément développer une offre légale et lutter contre les échanges illicites sur le peer-to-peer, la prévention et la répression ont commencé à être mises en ouvre dans le cadre des relations avec l’industrie musicale, les représentants de l’industrie cinématographique participant aux réunions que les différents acteurs ont avec les pouvoirs publics sur ce point.
S’agissant de la prévention, l’AFA travaille actuellement avec la SACEM et la Société Civile des Producteurs de Phonogrammes à la mise en place d’une procédure de relais de notification. Cette procédure permet, sur signalement d’ayants droit, d’adresser à l’internaute concerné un message lui relayant le signalement dont son FAI à fait l’objet à son sujet.
Afin d’éviter que seule une politique de répression soit mise en ouvre, les représentants de la filière cinématographique ont émis le souhait qu’une procédure dite de riposte graduée soit établie dans laquelle une telle procédure d’avertissements se substituerait à la plupart des procédures judiciaires.
Une telle procédure implique de la part des ayants droit la volonté de mettre en ouvre des mesures alternatives aux poursuites devant des tribunaux.
Sous réserve des conditions de mise en ouvre, notamment de l’accord de la CNIL sur l’ensemble de la procédure, l’AFA apporte son soutien à cette démarche et ses membres sont prêts, dans un cadre légal et réglementaire approprié, à apporter leur aide en tant que prestataires techniques.
Il faut rappeler si la loi « Informatique et Libertés » permet aux organisations représentant les ayants droit ou luttant contre la contrefaçon de collecter des données sur les personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, il est interdit aux fournisseurs d’accès Internet d’agir de même. Seuls les ayants droit seraient donc en mesure de conserver un historique des actions déjà engagées à l’égard des internautes.
La riposte graduée pourrait prendre la forme, dans un premier temps, d’envoi de messages par les fournisseurs d’accès Internet à destination de leurs utilisateurs identifiés par l’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle comme pratiquant des échanges illicites.
Il doit toutefois être précisé que la riposte graduée a une vertu de prévention mais ne saurait se substituer au rôle de l’Autorité judiciaire. Ainsi, si l’envoi de courriers aux internautes est envisageable, il ne saurait être question d’aboutir à une remise en cause du contrat conclu entre le fournisseur d’accès et un consommateur (réduction du débit offert ou coupures d’accès) en dehors de tout cadre judiciaire, sauf à envisager une évolution législative en ce sens qui offrirait aux fournisseurs d’accès toutes les garanties nécessaires.
L’industrie cinématographique suggère que les FAI engagent des diligences nécessaires et appropriées pour limiter les atteintes aux droits de propriété intellectuelle qu’entraîne un débit proposé aux consommateurs. Une telle demande, particulièrement floue, laisse ainsi entendre qu’une technologie (un certain débit proposé) pourrait entraîner un dommage. Cela revient à nier que la technologie par elle-même n’est ni positive, ni négative contrairement aux usages que l’on peut en faire. L’AFA ne peut donc qu’exprimer son inquiétude face à une telle demande.
S’agissant de la mise en place d’un observatoire des échanges de contenus sur l’Internet, si les organisations représentatives de l’industrie cinématographique peuvent légitimement la souhaiter, il ne saurait être question que cet organisme soit financé par les fournisseurs de services de communication électronique alors que ces derniers n’ont jamais formulé de demande de création d’un tel organisme. Les fournisseurs d’accès pourraient toutefois contribuer aux travaux de cet observatoire, notamment en fournissant certaines informations et données à leur disposition pouvant éclairer ses travaux.
Pour ce qui concerne la répression, diverses mesures peuvent être envisagées dans le cadre légal. Si l’industrie cinématographique a émis des réserves sur les actions pénales à l’encontre d’internautes (réserves que l’AFA partage), il existe de nombreuses autres procédures. A cet égard, les ordonnances sur requêtes déjà demandées par la SCPP ont été délivrées sans difficulté par les magistrats et exécutées promptement par les fournisseurs d’accès concernés.
L’AFA soutient par contre pleinement la proposition de l’industrie cinématographique de réserver les actions pénales aux personnes tirant un bénéfice commercial de la contrefaçon ou qui échangent de manière massive des ouvres protégées sans autorisation ou qui sont les premières à mettre à disposition sur des réseaux des ouvres protégées sans autorisation. Une évolution législative en ce sens consacrant cette distinction serait sans aucun doute souhaitable.
L’AFA espère que les éléments de réflexion contenus dans le présent document pourront utilement servir de point de départ à une discussion entre les fournisseurs d’accès Internet et les producteurs de cinéma.
Paris, 11 janvier 2005